
Un indû annulé: la CPAM rappelée à l’ordre pour ne pas avoir respecté les règles d’agrément et d’assermentation de ses agents enquêteurs

La prestation de serment de l’agent enquêteur de la CPAM est une condition essentielle de la validité de l’enquête.
Par un arrêt du 22 mars 2019, la Cour d’Appel d’Aix en Provence juge qu’un enquêteur n’était pas valablement assermenté lorsqu’il a procédé à l’enquête et que celle-ci est nulle.
Il faut malheureusement signaler que cette décision a été cassée par la Cour de Cassation en 2022.
Il s’agissait à nouveau pour la CPAM de demander à un infirmier de rembourser des sommes importantes au titre d’une prétendue « sur-activité » (en l’occurrence un nombre d’AIS3 considéré comme trop important).
La CPAM avait déclenché une procédure de notification d’indû à la suite d’une enquête administrative.
L’enquête avait été réalisée en septembre 2011 par un agent dit « assermenté ».
En première instance, l’infirmier avait demandé la communication du serment prêté par l’enquêteur, demande qui fut dédaignée par la CPAM.
Les demandes de la Caisse furent alors rejetées. Le tribunal avait considéré que la CPAM ne prouvait pas que l’enquêteur fût assermenté et qu’en ne répondant pas aux conclusions de l’infirmier, elle ne permettait pas au tribunal de faire droit aux demandes de la CPAM.
En appel, la Caisse communiquait enfin la copie de la carte professionnelle de l’agent. On s’apercevait alors qu’il existait plusieurs versions de cette carte, avec différentes dates d’agrément et différentes dates de prestations de serment.
L’une des cartes était même bizarrement raturée et surchargée …. la date de prestation de serment qui initialement était du 5 octobre 2009 avait été raturée et transformée en 10 octobre 2011 , sur une carte strictement identique.
En insistant pour avoir communication de tous les documents (agréments et prestations de serment), on finissait par reconstituer la chronologie de l’agrément et de la prestation de serment…

La CPAM avait pris un an de retard dans la procédure administrative d’agrément et de serment. L’enquêteur était tantôt non agréé tantôt non encore assermenté. Selon la Cour, il existait une « discontinuité » dans ses fonctions.
L’enquêteur avait d’abord fait l’objet d’une demande d’agrément qui donnait lieu à une « autorisation provisoire ». Mais alors que de telles autorisations sont valables 2x 6 mois maximum, ce qui signifie que l’agrément doit être donné dans le délai d’un an maximum, il n’avait obtenu l’agrément que 2 ans après.
La Cour en déduit qu’il y avait peut-être une « discontinuité » dans ses fonctions.
L’enquêteur avait prêté serment le 5 octobre 2009 mais au titre de son autorisation provisoire. Comme celle-ci ne pouvait plus produire d’effets au-delà d’un an, et après qu’il eût obtenu l’agrément le 4 mai 2011 (presque deux ans après…) , la CPAM faisait prêter serment à l’agent le 10 octobre 2011.
Or l’agent avait réalisé son enquête en septembre 2011, date à laquelle il était certes enfin agréé depuis le 4 mai 2011, mais pas encore assermenté.
La Cour d’Appel rejette donc en bloc l’enquête réalisée par cet agent ainsi que le prétendu indu. Elle condamne la CPAM à payer à l’infirmier une partie de ses frais d’avocat.
Cet arrêt est particulièrement remarquable par sa concision et sa précision.
Il examine dans le détail les dispositions réglementaires de deux arrêtés (30 juillet 2004 et 18 décembre 2006) qui avaient été produits intégralement et invoqués par l’infirmier, et en retire la disposition substantielle qui sert de base à la décision.
Les règles sont encore plus précises dans le nouvel arrêté du 5 mai 2014 qui désormais indique très clairement que :
L’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d’autorisation provisoire.
On retrouve ces principes dans tous les textes régissant les agréments d’agents en matière sociale, notamment l’arrêté du 23 avril 2017 qui fixe les conditions d’agrément des praticiens conseils qui prévoit que l’agrément définitif peut être accordé si le candidat est jugé satisfaisant « , et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d’autorisation provisoire « ;
La raison de ces textes relève du bon sens : au bout d’un an les informations données initialement et concernant l’agent, tout comme les éléments de l’enquête, donnés au directeur de la CNAM lors de la demande d’autorisation provisoire, sont périmés et ne peuvent plus servir de base à un agrément.
Un agent ne peut pas, comme c’était le cas ici, exercer avec une autorisation provisoire pendant 2 ans puis tout à coup recevoir son agrément. Car l’agrément est alors fondé sur des éléments envoyés 2 ans avant, et ceux-ci sont périmés tout comme l’enquête effectuée sur cet agent.
Catherine Marie KLINGLER
Avocat






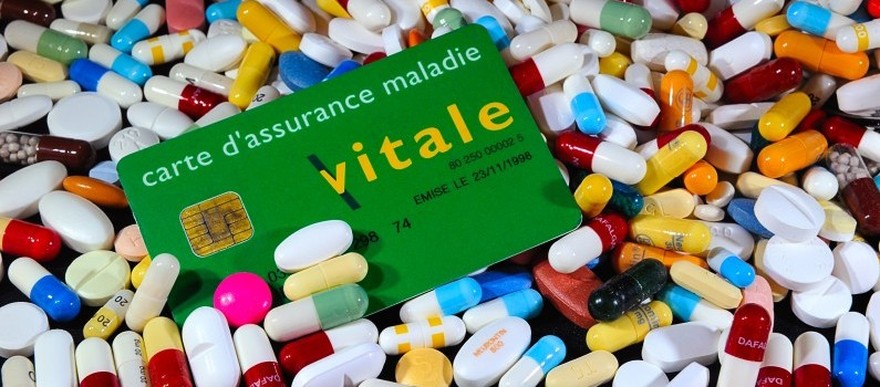



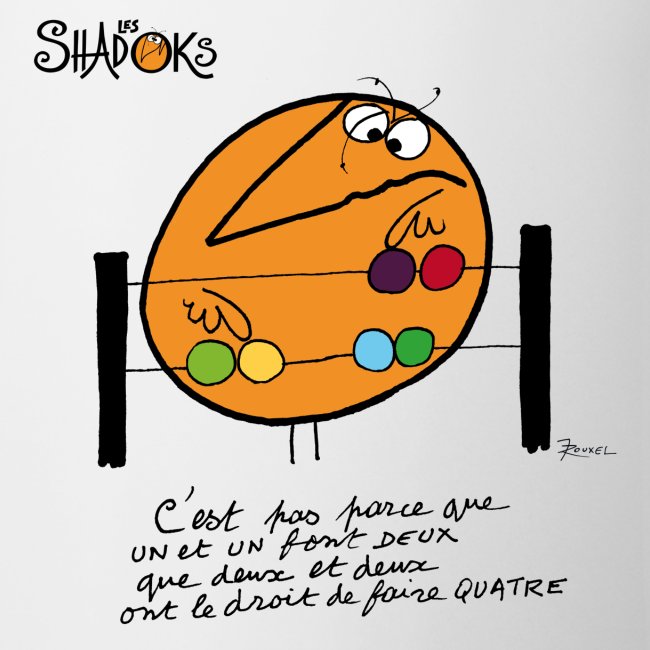

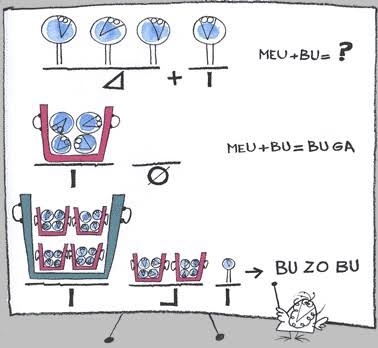

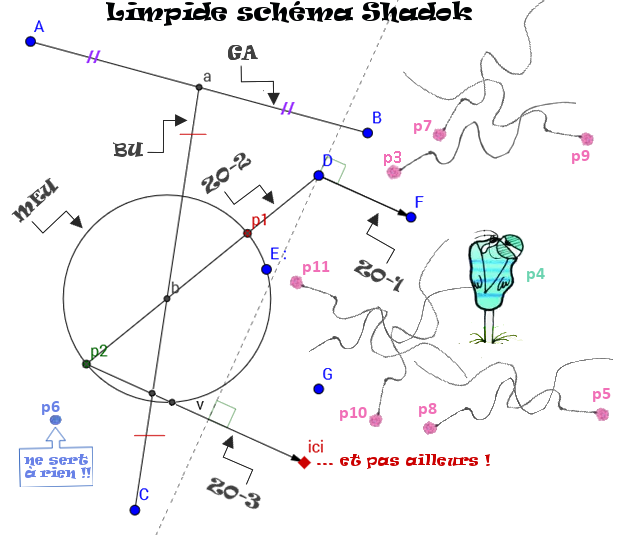
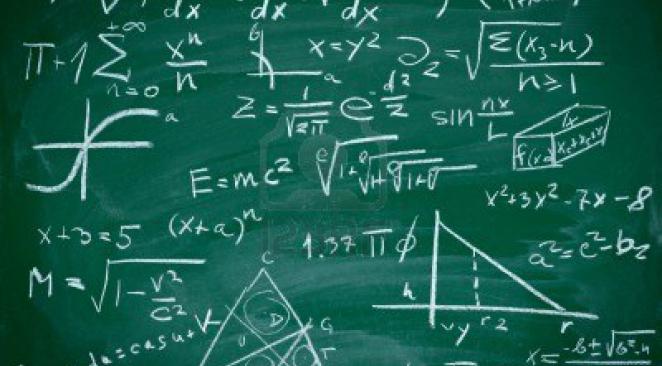






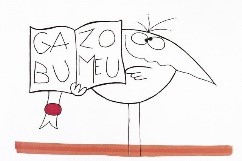




Commentaires récents